 |  |  |
|---|
La syndicaliste Jeudi 19 Janvier 20h30


En reconstituant ce fait divers trouble, Jean-Paul Salomé signe un film-dossier solide, constamment captivant.
Synopsis et détails
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…
Bande Annonce
Critiques
"Quand je fais des promesses, ce n’est pas en l’air. Je me bats pour les tenir." Être la tête d’affiche syndicale d’une multinationale en connexion très étroite avec les États ouvre des accès au plus haut niveau industriel et politique, mais quand on tente d’entraver les intérêts les plus puissants, le retour de bâton peut parfois être particulièrement violent, d’autant plus s’il l’on est une femme dans un univers dominé par les hommes. Maureen Kearney, incontournable déléguée CFDT pendant une vingtaine d’années chez le géant nucléaire français Areva, a ainsi payé de sa personne pour le découvrir, une histoire vraie qui a inspiré à Jean-Paul Salomé le très efficace et passionnant thriller La Syndicaliste, dévoilé au programme Orizzonti de la 79e Mostra de Venise.
Le 7 décembre 2012, Maureen (la toujours parfaite Isabelle Huppert) est découverte par sa femme de ménage dans le sous-sol de sa maison de banlieue parisienne. Attachée sur une chaise, un bonnet enfoncé sur la tête, elle a un A inscrit sur le ventre et le manche du couteau qui l’a tracé est enfoncé dans son sexe. Ouvrant le film, l’événement sera au cœur d’une intrigue à double détente (un très bon scénario écrit par le réalisateur et Fadette Drouard d'après le livre La Syndicaliste de Caroline Michel-Aguirre). Le récit repart d’abord quelques mois auparavant. La PDG d’Areva, Anne Lauvergeon (Marina Foïs), qui a toujours travaillé en harmonie avec Maureen, s’apprête à céder son poste. Lui succède Luc Oursel (Yvan Attal) que les deux femmes n’apprécient guère et réciproquement. Bientôt, une "gorge profonde" révèle à Maureen que Henri Proglio qui dirige l’autre géant national de l’énergie, EDF, manœuvre en secret et sous les radars de la tutelle étatique pour s’allier avec un groupe chinois afin de construire avec Areva des centrales nucléaires low cost. Déterminée à alerter les pouvoirs publics, Maureen attend le verdict de l’élection présidentielle et, une fois les socialistes revenus au pouvoir, informe le ministre des Finances Arnaud Montebourg qui temporise, puis les députés. Malgré les conseils de prudence des uns et les tentatives d’intimidation (de plus en plus directes) des autres, elle prend rendez-vous avec le président de la République. Mais elle ne le verra jamais pour cause d’agression le matin même. Pire encore, l’enquête de gendarmerie commence à mettre sa bonne foi en doute, la soupçonnant de simulation. Et si c’était le cas ?
"À quoi vous jouez ?", "cela vous excite de paraître plus importante que ce que vous n’êtes ?", "mêle toi de tes affaires, c’est le dernier avertissement", "je vous réduirai en miettes" : le film retranscrit à la perfection la violence prête à jaillir dans le monde en apparence feutré des affaires, la difficulté extrême à faire émerger et accepter la vérité issue des lanceurs d’alerte, les alliances vicieuses qui se trament si besoin pour les faire taire et l’acharnement supplémentaire que vaut la condition féminine. Rythmé, très bien construit, La Syndicaliste traite aussi du caractère dangereusement obsessionnel et addictif du pouvoir et du surinvestissement au travail, injectant suffisamment de nuances pour être à la fois une œuvre grand public captivante et un sujet de sujet de réflexion citoyenne de première importance.
Fabien Lemercier (www.cineuropa.org)

L'histoire réelle documentée à partir de l'enquête de la journaliste d'investigation Caroline Michel-Aguirre a servi de base au scénario coécrit par le réalisateur et Fadette Drouard, experte de la dramaturgie scénaristique (cf. Memory Box, Papicha, Patients). Le regard rétrospectif sur l'histoire de la France contemporaine est au cœur de l'intrigue de ce thriller politico-judiciaire où les noms des vrais protagonistes ont été conservés.
Pour autant, Jean-Paul Salomé oriente son récit vers l'hommage à une figure héroïque féminine de la résilience en tant que lanceuse d'alerte. Ainsi, la première partie descriptive qui se rapproche davantage du cinéma de la dénonciation des rouages économico-politiques marqués par les influences à la fois du cinéma de Stéphane Brizé et des enquêtes journalistiques notables de Denis Robert, laisse la place à un portrait intime et psychologique de femme où le doute quant à son innocence est volontairement mis en scène durant l'enquête Ainsi, le film bien que documenté perd ensuite en rythme après un début trépidant. Malgré tout, il en découle avec un montage parfois maladroit une dénonciation subtile de la violence des préjugés sexistes aussi bien dans l'enquête policière biaisée, que de la condamnation du propre avocat de la victime en tant que femme, sans parler des différentes violences gynécologiques. Cette deuxième partie sous forme de long et éprouvant chemin de croix se révèle pertinent dans sa dénonciation de la violence patriarcale même si l'on perd au même moment la description d'un pouvoir politique et économique nauséabond.
Un film dossier globalement fidèle à l'enquête journalistique et un point de vue du réalisateur porté par l'héroïsation féminine d'une porteuse d'alerte dont la vocation politique s'illustre par une indépendance d'esprit protégé du milieu d'une élite sociale endogame.
Les acteurs et actrices du film autour d'un brillant choix de casting excepté François-Xavier Demaison sous-employé, jouent en outre avec conviction et profondeur leur personnage au service de l'intrigue et d'une mise en perspective des choix historiques d'hier pesant de tout leur poids sur la réalité d'aujourd'hui.
Fiche technique
Scénario : Jean-Paul Salomé et Fadette Drouard, adapté du livre La Syndicaliste de Caroline Michel-Aguirre
Images : Julien Hirsch
Montage : Valérie Deseine et Aïn Varet
Musique : Bruno Coulais
Son : Christoph Schilling, Louis Bart, Damien Guillaume, Marc Doisne, Thomas Wargny
1er assistant réalisateur : Mathieu Thouvenot
Décors : Françoise Dupertuis
Costumes : Marité Coutard
Casting : Juliette Denis
Scripte : Anaïs Sergeant
Produit par : Bertrand Faivre
Société de production : Le Bureau
En coproduction avec : Heimatfilm, France 2 Cinéma, Restons Groupés Productions, Les Films Du Camélia
Coproduit par : Bettina Brokemper
Distributeur (France) : Le Pacte
Sortie salles (France) : 1er mars 2023

Le réalisateur Jean-Paul Salomé
Jean-Paul Salomé est un réalisateur français né en 1960.
Jean-Paul Salomé est un réalisateur français, ancien assistant de Claude Lelouch.
Après des courts, des documentaires et des efforts télévisuels, Jean-Paul Salomé réalise deux comédies à succès dans le paysage difficile du cinéma français des années 90. Les braqueuses, sorti en été, avec un casting féminin pas très bankable (Catherine Jacob, Clémentine Célarié, Alexandra Kazan, et Annie Girardot pour un come-back salué), réalise près de 180 000 entrées, en toute indépendance.
Les comédies
Après ce succès d’estime, il réalise un vrai succès populaire avec Restons groupés qui, malgré une date de sortie en septembre, attire 820 000 curieux. Bruno Solo, Emma de Caunes, Judith Henry, Samuel Le Bihan, Claire Nadeau ou Bernard Le Coq parviennent malgré une notoriété de seconds rôles ou d’espoirs du cinéma, à susciter l’euphorie pour son distributeur Bac Films.
Les années 2000
Dans les années 2000, le cinéaste est invité à réaliser des productions d’envergure, avec des budgets plus élevés. Successivement, il est amené à adapter Belphégor, le fantôme du Louvre (avec Sophie Marceau, Frédéric Diefenthal, Michel Serrault) et Arsène Lupin (avec Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Eva Green) au cinéma. Il réalise également un film de guerre au féminin, avec Sophie Marceau, Les femmes de l’ombre (2008). Si Belphégor est un succès (2 000 000 entrées), Arsène Lupin déçoit (1 184 240) et Les femmes de l’ombre aura pour lui une carrière internationale. Dans les trois cas, les critiques sont assassines.
Des années 2010 en retrait (en apparence)
Jean-Paul Salomé connaît deux désaveux dans les années 2010. Le caméléon, polar schizophrène en anglais, sur un fait divers bien connu, est un flop, malgré la présence d’un casting international (Marc-André Grondin, Famke Janssen, Ellen Barkin). Et Je fais le mort, au budget plus modeste, passe relativement inaperçu, malgré sa superbe brochette d’acteurs (Francois Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste, Anne Le Ny).
En 2013, alors que sort son septième long métrage, Jean-Paul Salomé prend la présidence d’Unifrance, pour représenter le cinéma français à l’international. Il laisse de ce fait sa carrière personnelle de côté pour se consacrer à ce grand travail d’ambassadeur qu’il accomplira avec succès.
Le cinéaste revient en 2020 avec La Daronne, une comédie policière, avec Isabelle Huppert qui démontre sa grande proximité avec les comédiennes qu’il aime propulser en tête d’affiche de ses longs métrages. Isabelle Huppert succéde ainsi au casting féminin des Braqueuses, et à celui des Femmes de l’ombre (Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain, Deborah Francois)…

Les interviews
Propos d'Isabelle Huppert
Jouer une personne réelle, vivante, cela offre des pistes pour l’allure du personnage, a fortiori dans le cas de Maureen Kearney, qui ne correspond pas tout à fait à l’idée qu’on peut se faire d’une syndicaliste - bien que les gens soient toujours surprenants et différents de l’image qu’on se fait d’eux à travers leur fonction. On a pu s’inspirer de la manière dont elle s’habille, se maquille, se coiffe, de sa blondeur, de son chignon, et aussi des bijoux qu’elle porte. Cela m’intéressait de la rencontrer, mais le jeu reste toujours un travail d’imaginaire, et on peut se détacher de la réalité autant qu’on le veut. Je ne suis pas sûre qu’avoir un « vrai » modèle accroisse la responsabilité vis-à-vis de la personne que l’on joue. D’abord la responsabilité est beaucoup sur les épaules du metteur en scène ; ensuite, l’intérêt de ce sujet, parmi d’autres, c’est le scepticisme : laisser l’ambiguïté fabriquée par le regard des autres sur le personnage.
Quand on a trouvé l’aspect physique du personnage, le reste coule de source. D’autant que, grâce aux talents du coiffeur, de la costumière, de tous ceux qui ont travaillé sur l’apparence de Maureen, ce n’était pas un déguisement, un artifice qui aurait pu me gêner, cela faisait vraiment partie de moi. Cela aurait été plus difficile et moins amusant si j’étais restée moi-même, sans ses choix qui relèvent aussi du jeu de masque au théâtre. Par exemple, les lunettes étaient très importantes : elles modifient l’aspect de la personne qui les porte, et le regard que l’on porte sur elle. Elles empêchent l’accès direct au regard et changent la vue, provoquant une légère transformation de la réalité. C’est intéressant, les lunettes au cinéma : je me souviens que j’en portais dans L’Ivresse du pouvoir, de Claude Chabrol.
Je ne me suis pas posé la question de la culpabilité ou de l’innocence de Maureen. Ce qui m’intéressait, c’est le trouble qu’elle a suscité et que curieusement elle suscite encore, à en croire les documentaires récents consacrés à l’affaire. Tout au long du film, le parcours du personnage est singulier, depuis le début de son combat jusqu’à la dernière scène, sa déposition magnifique devant la commission de l’Assemblée Nationale. Maureen se bat contre une sorte d’hydre tentaculaire qui la dépasse complètement. Et en même temps, elle se bat aussi pour une chose très simple : sauver des emplois. Elle pourrait lâcher, mais il y a chez elle la volonté farouche de livrer bataille et au fond d’être un personnage plus grand que ce à quoi elle était vouée. C’était une syndicaliste, on ne lui demandait pas de conduire une armée mais elle s’est bâti un petit royaume à la tête duquel elle a décidé de régner et de résister. Elle veut aussi s’inventer une vie assez différente de celle qu’elle a. À l’arrivée, elle est seule contre tous, c’est son côté Erin Brockovich ! Mais ses choix vont la broyer.
La violence de ce que vit Maureen met en danger sa vie privée. Elle fissure son cadre familial, même si, au-delà des silences, il reste un peu d’humour entre elle et son mari, joué par Grégory Gadebois. C’est un peu comme si, habituée à prendre la parole dans certaines circonstances qu’elle maîtrise bien, les mots lui manquaient : je pense à la scène du premier procès, où, dans un contexte imposant, Maureen se trouve fragilisée comme jamais. J’ai imaginé beaucoup de choses pour ce moment-là, on peut tout imaginer ! Par exemple, au cas où elle elle aurait tout inventé, elle perdrait alors ses moyens devant l’énormité de son mensonge. C’est en tout cas ce que peuvent penser ceux qui ne la croient pas et la voient s’effondrer, avec, selon eux, tout l’échafaudage qu’elle a construit... Quand tout le monde vous accuse, peut- être finit-on par douter de sa propre innocence. Maureen revient de très loin quand elle décide de faire appel de sa condamnation. C’est vraiment une décision personnelle qui témoigne d’une ténacité, d’un courage, d’une volonté de se faire justice assez impressionnante. Ainsi, la scène où elle essaie de reconstituer elle-même les circonstances du viol. Elle est seule à pouvoir le faire, tellement elle a été lâchée de toute part, tellement est grande sa solitude. Elle n’a pas d’autre choix que le pragmatisme, voir si ce dont on l’accuse est possible.
J’ai cité le nom de Claude Chabrol et je crois qu’il y a dans le film quelque chose de chabrolien, une certaine sécheresse mais dans le bon sens, rien de sentimental, peut-être une espèce d’ironie empreinte de morale. J’adore travailler avec Jean-Paul Salomé, on s’entend vraiment très bien, comme cela avait été le cas sur La Daronne. Il n’y a aucune hésitation dans sa mise en scène, ce qui est toujours confortant pour un acteur. Et il y a entre nous une grande confiance réciproque. Les bons cinéastes ne sont jamais interventionnistes vis-àvis de leurs acteurs ou ils le sont d’une manière invisible qui donne de l’énergie de l’assurance, jamais d’une manière qui entrave.
(Dossier de presse)
Pour aller plus loin
Maurine Kearney

A Ecouter
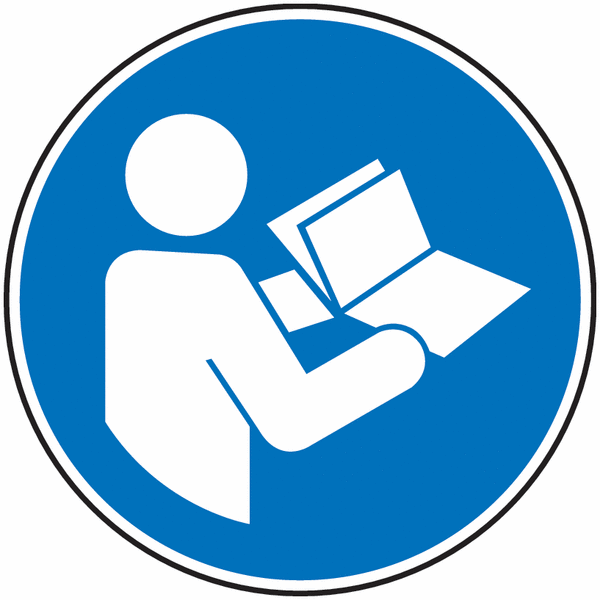
Pour aller plus loin; le livre

Areva, portrait d’une «Syndicaliste» meurtrie
Caroline Michel-Aguirre dresse un parcours détaillé de Maureen Kearney, condamnée en 2017 pour avoir mis en scène son agression, avant d’être acquittée l’année suivante.
Victime d’une affaire d’Etat ou grande affabulatrice ? Près de sept ans après la découverte, en décembre 2012, de Maureen Kearney attachée sur une chaise dans son pavillon de la banlieue parisienne, un «A» gravé sur le ventre et un manche de couteau enfoncé dans le vagin, l’affaire reste un mystère. L’ex-syndicaliste d’Areva gênait-elle vraiment les obscures tractations de l’industrie nucléaire française avec la Chine, ou a-t-elle pris un peu trop à cœur son rôle de secrétaire du comité de groupe européen ? Au point de mettre en scène son agression - comme le laissent penser plusieurs éléments du dossier - afin de faire échec à ces négociations qui, selon elle, menaçait des milliers d’emplois en France ?
A ces questions, la journaliste Caroline Michel-Aguirre ne répond pas. Auteure de la Syndicaliste, la responsable de la cellule investigation de l'Obs n'apporte pas d'éléments supplémentaires sur la réalité de l'agression de Maureen Kearney. Pas davantage, en tout cas, que ce qu'a révélé la presse jusqu'ici, et surtout les deux audiences qui se sont tenues devant la justice. Et qui ont conduit, pour la première, à une condamnation de l'ancienne syndicaliste, en juillet 2017, à cinq mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende pour «dénonciation mensongère» ; et pour la seconde, à un acquittement pour les mêmes faits en novembre 2018.
Répertoire
La richesse de l’ouvrage - outre ses qualités d’écriture - réside plutôt dans les éléments de contexte qu’il apporte à l’affaire. Telles ces menaces proférées par l’inquiétant intermédiaire Alexandre Djouhri (proche d’Henri Proglio, PDG d’EDF à l’époque) à l’encontre d’Anne Lauvergeon, numéro 1 d’Areva, alors qu’EDF négociait secrètement avec la Chine des transferts de technologies qui pouvaient fragiliser Areva. Mais aussi, et peut-être surtout, dans les informations sur Maureen elle-même et sa famille, alors que l’intéressée s’était refermée comme une huître, et pendant des années, après son agression réelle ou supposée.
On découvre ainsi un peu mieux cette prof d’anglais d’origine irlandaise, entrée un peu par hasard au sein d’Areva pour enseigner sa langue maternelle aux cadres, et qui va, au fil des années, se hisser au plus haut échelon de la hiérarchie syndicale, dans un monde - le nucléaire - largement masculin. Un investissement surprenant pour quelqu’un qui n’est ni français - le nucléaire a une forte dimension nationale - ni lié au cœur de métier de cette industrie. Une vraie femme de réseau, dont le répertoire renfermait toute une partie de la classe politique - de droite comme de gauche - qui rapidement a oublié son numéro après son agression présumée. Bernard Cazeneuve, élu d’un département fortement nucléarisé (la Manche), en contact régulier avec elle avant l’attaque et disparu ensuite, en sort peu grandi. Seule Anne Lauvergeon semble l’avoir soutenue dans son calvaire.
La journaliste nous dévoile aussi ses fantômes : Maureen, jeune adulte, avait déjà subi un viol, avant d’apprendre, quelques années plus tard, que son propre fils avait connu un drame du même ordre. Une femme solide et fragile à la fois, énergique et profondément investie dans ses responsabilités syndicales, mais aussi, sur la fin, à deux doigts de tout envoyer balader. Selon Caroline Michel- Aguirre, son remplacement à la tête du comité de groupe européen était d’ailleurs déjà programmé, un mois avant son agression.
Cas similaire
On découvre également une bonne vivante, entourée d’un mari aimant, de copines fidèles et d’amis en pagaille qui passent jusqu’à tard le soir dans leur maison de banlieue ou sur leur lieu de vacances pour refaire le monde, entre joints et bières. Bref, rien d’une femme isolée prête à une incroyable mise en scène pour attirer l’attention. Même si les douleurs du passé et la charge de sa fonction la conduisaient à être suivie par un psychiatre.
L'ouvrage, enfin, s'achève sur un chapitre troublant : la rencontre de Caroline Michel-Aguirre avec la victime d'un cas similaire. Six ans plus tôt, en juin 2006, la femme d'un cadre de Veolia avait été retrouvée violée et tailladée au ventre dans son pavillon de banlieue, alors que son mari était en conflit ouvert avec sa direction. Or, la direction de Veolia était occupée à l'époque par Henri Proglio, qui n'était «rien», rappelle Alain Marsaud cité dans l'ouvrage, sans Alexandre Djouhri. Une agression qui, là aussi, n'a laissé aucune trace, et dont la victime, une fois encore, était soupçonnée par les enquêteurs d'avoir tout inventé… L'affaire Kearney est peut-être loin d'avoir livré tous ses mystères.





